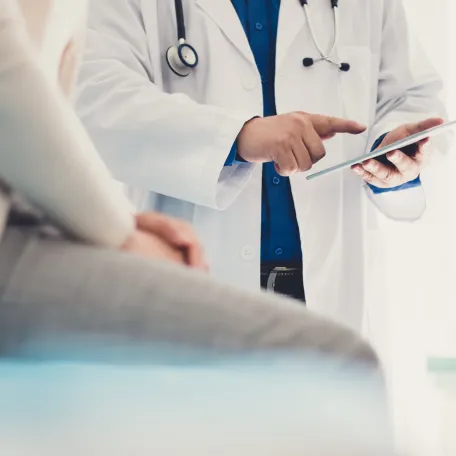4. Les traitements de l’herpès génital
Il existe des médicaments antiviraux contre l’herpès génital. Ces traitements sont efficaces pour diminuer la durée des symptômes, réduire l’intensité des douleurs et raccourcir la durée d’excrétion virale.
Ils n’éliminent pas définitivement le virus, mais permettent de mieux contrôler les épisodes.
Le traitement dépend de la situation clinique : primo-infection, récurrence, ou prévention des poussées fréquentes.
Aucun intérêt des traitements locaux
Les traitements locaux quels qu'ils soient (crèmes antivirales) n'ont jamais démontré leur efficacité.
Bien qu'ils soient régulièrement utilisés, aucune étude scientifique n'a à ce jour démontré leur intérêt, ni sur la durée de l'épisode, ni sur la prévention des récidives.
Traitement de la première poussée (primo-infection)
La première infection par l’herpès génital est en général plus longue, plus douloureuse et plus gênante que les poussées suivantes. C’est pour cette raison qu’un traitement antiviral est systématiquement recommandé, afin de réduire la durée des symptômes.
En France, les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS, 2024) préconisent un traitement antiviral sur une durée courte de 5 jours, afin de favoriser la prise correcte et complète du médicament.
Cependant, les nouvelles recommandations européennes soulignent que, dans la pratique, une durée de 5 jours peut parfois être insuffisante, en particulier lors de la première poussée. Elles recommandent un traitement d’au moins 7 jours, afin d’obtenir une meilleure efficacité clinique.
Ainsi, chez l’adulte immunocompétent en primo-infection le traitement recommandé est :
- 1re intention : valaciclovir 500 mg 2 fois par jour pendant 5 jours (pouvant être prolongé jusqu’à 7 jours).
- 2e intention : aciclovir 200 mg 5 fois par jour pendant 5 jours (pouvant être prolongé jusqu’à 7 jours).
Chez la femme enceinte : même schéma que chez l’adulte immunocompétent.
Chez l’immunodéprimé non sévère vivant avec le VIH (CD4 > 200/mm³) : même schéma également.
Chez l’immunodéprimé sévère la dose et la durée du traitement seront majorés.
Traitement des récurrences
Les récidives sont en général plus courtes et moins intenses.
Le traitement doit être débuté le plus tôt possible, idéalement dès les premiers signes cliniques. La HAS recommande également des traitements plus courts qu'auparavant sur 3 jours.
Intérêt d'un traitement préventif
Un traitement antiviral préventif, pris au long cours, peut être proposé afin de réduire la fréquence des poussées, leur intensité, et le risque de transmission au partenaire.
Selon les recommandations françaises, ce traitement est classiquement indiqué chez les personnes présentant plus de 4 à 6 poussées par an, notamment lorsque le retentissement sur la qualité de vie est important et/ou en raison du risque de transmission au partenaire.
Les nouvelles recommandations européennes apportent cependant une évolution importante puisque le traitement préventif peut désormais être proposé quel que soit le nombre de récidives annuelles, même en dessous de 6 épisodes par an, dès lors qu’un bénéfice est attendu pour le patient (confort, anxiété, vie intime, prévention de la transmission).
La dose exacte dépend de l’antiviral prescrit et est adaptée au nombre de poussées habituellement observées sur une année.
Il s’agit le plus souvent d’un traitement à prendre une fois par jour pendant 6 à 12 mois.
Ce type de traitement permet de réduire de façon notoire le nombre d'épisodes, l’excrétion virale et ainsi le risque de transmission. En revanche cela ne permet pas d’éliminer définitivement le virus qui reste malgré tout latent dans les ganglions nerveux.
Rapports protégés
Au cours des poussées, il est recommandé d'utiliser un préservatif tant que subsistent les lésions afin de limiter les risques de contamination du partenaire.
La protection n'est toutefois pas totale, notamment en cas de localisations cutanée ou vulvaire des lésions.
Quels conseils suivre ?
Démystifier l'herpès génital
L'herpès génital est une infection sexuellement transmissible, mal prévenue par le port du préservatif. Il n'existe pas de risque de contamination indirecte, le virus étant très fragile en milieu extérieur. Des précautions doivent être prises au cours de la grossesse, car il existe un danger en cas de contamination de l'enfant pendant l'accouchement.
Le virus peut rester endormi et ne se manifester qu’après des années
La survenue d'un herpès génital au sein d'un couple stable ne doit pas nécessairement faire suspecter un rapport extraconjugal. En effet, l'herpès a pu être contracté il y a très longtemps, au début de la vie sexuelle d'un individu, être resté latent, c'est-à-dire endormi, pendant des années, et resurgir inopinément, des années plus tard, à la faveur d'un stress, d'une fatigue, d'une autre infection ou même parfois sans aucune raison…
Le préservatif ne protège pas totalement de l'herpès
Le préservatif évite la contamination au contact des lésions situées sur les muqueuses couvertes par celui-ci ou à partir des sécrétions génitales chez quelqu'un ne présentant pas de symptômes, mais pas la contamination par les lésions cutanées ou vulvaires.
Le port du préservatif est recommandé en cas de lésion visible, lors des poussées.
L'herpès ne s'attrape pas n'importe où, ni n'importe comment
Le virus de l'herpès est un virus fragile, qui ne vit que très peu de temps en dehors de son hôte. Il n'existe donc pas de risque de transmission indirecte dans les piscines ou par le siège des toilettes. La contamination ne s'effectue que par un contact direct, intime, et prolongé.
Quelques mesures à prendre en cas de grossesse
Un des risques liés à l’herpès génital pendant la grossesse est la transmission du virus au nouveau-né au moment de l’accouchement par contact avec des lésions maternelles (vésicules ou ulcérations). L’herpès néonatal peut être grave et nécessiter une prise en charge urgente. Une prise en charge obstétricale par une équipe spécialisée doit être proposée à toute femme enceinte présentant une primo-infection (c'est-à-dire un premier contact avec le virus de l'herpès) ou une récurrence herpétique pendant la grossesse. Un traitement antiviral préventif (aciclovir ou valaciclovir) peut être recommandé en fin de grossesse pour réduire le risque de poussée au moment de l’accouchement et une césarienne sera alors discutée au cas par cas.